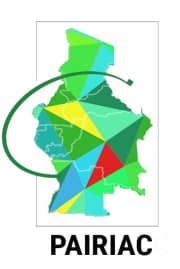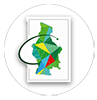DOUALA, CAPITALE DE LA SÉCURITÉ AGROALIMENTAIRE EN AFRIQUE CENTRALE

Cadre juridique prometteur, défis techniques à relever
Depuis son entrée en vigueur en 2014, l’Accord de Partenariat Économique (APE) entre le Cameroun et l’Union européenne a ouvert des perspectives encourageantes pour les exportateurs camerounais. Cet accord, conçu comme un levier pour intégrer durablement l’économie camerounaise dans le commerce mondial, repose sur une logique simple : favoriser le développement économique par le commerce, tout en accompagnant les acteurs locaux dans leur adaptation aux normes européennes.
Mais si l’accès au marché européen est facilité, il reste conditionné à un strict respect des normes SPS, souvent source de blocages. Selon les données préliminaires partagées par les organisateurs, certaines catégories de produits, comme les fruits frais, les huiles végétales ou les denrées transformées, font face à des taux d’interception élevés, causant des pertes financières importantes et affectant la crédibilité des opérateurs africains.
« Il ne s’agit pas seulement de produire, mais de produire juste », souligne un expert en certification SPS contacté avant l’événement. « La traçabilité, la qualité sanitaire, la vérification des origines, la gestion des intrants, la protection des variétés – tous ces éléments doivent être maîtrisés pour que nos produits soient acceptés sans réserve dans les marchés les plus exigeants. »
Réponse coordonnée à une problématique régionale
Le défi des normes SPS n’est pas propre au Cameroun. Il concerne toute la région Afrique centrale, où les cadres réglementaires varient d’un pays à l’autre, rendant difficile l’harmonisation attendue par les partenaires européens. Si la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) a amorcé l’élaboration d’une politique phytosanitaire commune, la Commission Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC) explore elle aussi des voies d’harmonisation sanitaire. Cette fragmentation complique la mise en place de systèmes de contrôle efficaces et rend difficile l’interopérabilité des certifications.
C’est dans ce contexte que l’atelier de Douala, organisé avec par le PAIRIAC entend poser les bases d’un plan d’action régional pour le renforcement de la conformité SPS. À travers des études de cas inspirantes – dont celle de la Task-Force Mangue du Cameroun (TFMC), modèle de concertation entre pouvoirs publics et exportateurs –, les participants auront l’opportunité d’identifier des bonnes pratiques transférables à d’autres filières et pays.
Des solutions concrètes à portée de main
Les discussions prévues lors de l’atelier ne manqueront pas de pragmatisme. Des sessions techniques permettront d’explorer des outils numériques comme ePhyto, système électronique de certificats phytosanitaires qui simplifie les formalités douanières, ou encore TRACENT, la plateforme de traçabilité des flux agricoles. Ces innovations digitales, combinées à une formation accrue des agents de contrôle, sont présentées comme des leviers stratégiques pour moderniser les systèmes SPS locaux.
Autre sujet central : la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale. Alors que les viandes, poissons et produits laitiers représentent un segment important des exportations potentielles, les normes de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) imposent des procédures rigoureuses d’abattage, de transformation et de transport. Plusieurs experts insistent déjà sur la nécessité de restructurer les infrastructures d’abattage et de laboratoires d’analyse, afin de garantir la qualité des produits jusqu’au consommateur final.
La question des emballages en bois, soumis à la norme internationale ISPM 15 visant à prévenir la propagation d’insectes nuisibles, sera également abordée. Elle illustre à quel point les détails techniques peuvent avoir un impact décisif sur l’acceptabilité des marchandises à l’exportation.
Protéger les marques locales, valoriser les terroirs africains
Au-delà des aspects techniques, l’atelier mettra également l’accent sur un autre pilier essentiel : la protection de la propriété intellectuelle. Dans un marché globalisé, la reconnaissance des appellations d’origine protégée (AOP) ou des indications géographiques (IG) peut faire toute la différence. Le Cameroun, avec ses produits emblématiques comme le cacao du Centre, le poivre de Béti ou le café robusta du Nord-Ouest, dispose d’un capital symbolique à exploiter pleinement.
« Nos produits méritent d’être connus sous leur vrai nom, avec leurs caractéristiques authentiques », affirme M. Tchouamé, consultant en propriété industrielle, contacté avant l’événement. « Protéger une marque, c’est investir dans la confiance. Et c’est cela qui permet de pénétrer durablement les marchés exigeants comme celui de l’UE. »
Vers un plan d’action régional ambitieux
À l’issue de ces trois jours de débats riches et constructifs, plusieurs conclusions devraient se dessiner. D’abord, la nécessité d’une approche coordonnée entre les différents pays de la région, afin d’éviter les disparités réglementaires. Puis, la priorité donnée à la formation continue des techniciens agricoles, des inspecteurs sanitaires et des producteurs eux-mêmes. Enfin, l’appel à davantage d’investissements dans les infrastructures de contrôle et de certification.
Le projet de plan d’action régional, élaboré collectivement pendant les travaux de groupe, prévoit notamment :
• La création d’un réseau régional d’échange d’informations SPS ;
• L’adoption progressive de normes harmonisées dans les deux espaces (CEMAC et CEEAC ) ;
• Le développement d’un observatoire régional des non-conformités à l’exportation ;
• Le renforcement des capacités des laboratoires nationaux d’analyse ;
• Une campagne de sensibilisation ciblée à destination des PME agricoles.
Pour les organisateurs, cet atelier de Douala constitue un tournant. « Nous ne partions pas de zéro, mais nous avançons désormais avec une feuille de route claire », affirme M. Stéphane André, chef de la Section Commerce de l’Union européenne au Cameroun. « L’objectif est ambitieux : doubler les volumes d’exportation des produits agroalimentaires vers l’UE d’ici 2030, tout en garantissant la sécurité alimentaire et la pérennité des filières. »
Pour une agriculture africaine qui conquiert l’Europe
Alors que l’atelier s’ouvre, les attentes sont grandes. Cette assise s’inscrit dans une dynamique plus large : redonner à l’Afrique centrale une place de choix dans le commerce agricole international. Derrière chaque mangue expédiée depuis Douala, derrière chaque palette de gomme arabique en transit vers Kribi, c’est une vision nouvelle de l’agriculture africaine qui se construit – plus inclusive, plus compétitive, et résolument orientée vers l’exportation.